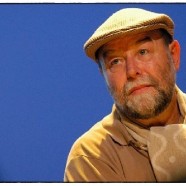
Henri Texier, de René Thomas à Label Bleu #2
Henri Texier : 50 ans de bouffées de souvenirs
De sa fidélité à Label Bleu au souvenir ému de René Thomas.
Propos recueillis par Claude Loxhay / Photos : Jos Knaepen
En terre picarde, après sa carte blanche du 3 mars, en compagnie de Michel Portal, Thomas de Pourquery, Bojan Z, Manu Codjia et Edward Perraud et dans la foulée du concert de son Sky Dancers Sextet le 4 mars, au sein de la très fonctionnelle Maison de la Culture d’Amiens, Henri Texier évoque son histoire avec Label Bleu, son enfance, sa découverte du jazz et sa rencontre avec Bud Powell, Dexter Gordon et René Thomas. Une vraie plongée dans des souvenirs émouvants, quelques heures avant le concert final de Rokia Traoré.
#2
Du « tonton africain » à
René Thomas.
Comment avez-vous découvert le jazz ?
C’est très simple. Mes parents étaient d’une famille très modeste, originaire de Bretagne et « émigrée » à Paris parce que mon père travaillait à la SNCF : il était poseur de rails. Il était venu à Paris pour gagner sa croûte. Grâce à la SNCF, on avait les voyages gratuits, en troisième classe et, tous les samedis après-midi, après avoir commencé sa journée à 4 heures du matin, mon père nous emmenait en Bretagne, chez sa mère. On ramenait les œufs frais, la saucisse bretonne, le beurre salé qu’on ne trouvait pas à Paris et la galette de sarrasin. Le cordon ombilical n’a jamais été coupé. Ma mère était frustrée de ne pas avoir pu poursuivre ses études pour mille et une raisons. Elle devait garder les vaches, c’était la misère : chez ma tante, il n’y avait pas d’eau, pas d’électricité. En outre, étant l’aînée, ma mère avait dû s’occuper de ses petits frères, avant de se marier comme au moyen âge: c’est du Zola. L’histoire du mariage de mes parents, on a l’impression d’être au fin fond du Maghreb ou de l’Afrique, la Sicile ou la Calabre. A Paris, elle faisait des ménages, de la confection pour que nous puissions faire de la musique, mes sœurs et moi : l’une faisait du piano, l’autre du violon, sur une vraie boîte à cigare, et moi du piano aussi. La SNCF, à l’époque, c’était génial, il y avait des colonies de vacances, un économat, un dispensaire et on avait des cours de musique gratuits : c’était du paternalisme d’Etat. Cela a de l’importance pour l’histoire du jazz après, parce que c’est de là que je viens. Ma mère finit par se procurer un piano droit, une récupération chez des bourgeois pour qui elle faisait de la confection. On l’avait placé dans la chambre que j’avais récupérée de mes sœurs. Tout cela permet d’arriver au jazz. Fascinée par la musique, elle me fait donner des leçons de piano et de solfège : pour moi, c’était comme le catéchisme. C’est horrible : de l’école en plus de l’école. Le solfège, j’y étais réfractaire. A l’époque, on utilisait encore le martinet. Je me souviens d’une séance où ma mère me faisait répéter mes leçons de solfège, que je poursuivais dans les sous-sols de la gare Saint-Lazare où il y avait l’harmonie de la SNCF. Je n’avais rien retenu et elle me donnait des coups de martinet sous la table, or j’avais encore des culottes courtes. A 14 ans, j’étais encore en culottes courtes : ma mère faisait tous nos vêtements. Tout le monde avait des fringues et moi, j’étais en culottes courtes : c’est un bouquin, c’est Hervé Bazin. Elle croyait taper sur les pieds de la table, mais c’était sur mes jambes : j’avais des cloques sur les mollets : voilà mon apprentissage musical. Je fais des exercices de piano, la méthode Hanon, des trucs de mômes hyper chiants, avec une prof basque : ça me saoule. Je suis malheureux, c’est horrible. Ma mère insiste : « Apprends la musique, persiste, un jour, ça t’ouvrira des portes. » Elle ne croyait pas si bien dire. Et là, il y a un tonton de Bretagne, de Rennes, chauffeur de bus à la RATP dont le dépôt est à Clichy, un quartier populaire : il vient et joue du boogie woogie, vachement bien. Et, là, révélation instantanée. Il me montre comment faire et ça, je l’apprends tout de suite : c’est pour cela que je suis un bluesman, parce que le boogie woogie, c’est le blues. Le truc ultra « roots ». Après, il faisait quelques variations. Il était batteur dans des bals en Bretagne. Le premier groupe que j’ai constitué, c’est un trio, comme celui de Benny Goodman, avec Teddy Wilson au piano et le batteur, je crois que c’était Jo Jones. A la clarinette, c’est Alain Tabar Nouval que j’ai rencontré au lycée. Moi, je jouais du piano comme une patate, lui swinguait le plus possible et le tonton jouait New Orleans, beaucoup sur la caisse claire. Cela commence comme cela. Notre idole, c’est Sidney Bechet, une immense star à l’époque, aussi connu qu’Edith Piaf ou Maurice Chevallier : les fauteuils cassés à l’Olympia, c’est pas Bécaud, le premier, c’est lui. Avec mon pote Tabar Nouval, une famille d’Antillais, on fait le même chemin tous les deux. Il habite le bloc d’à côté, dans l’avenue de Clichy, on est dans le même lycée. Lui est un peu plus âgé, c’est parti. Le « tonton d’Afrique », comme on l’appelait, est vite dépassé : lui jouait pour s’amuser, nous, nous étions inoculés, il n’y avait que la musique qui comptait. C’est le truc des mômes. On ne connaissait personne. Pour rencontrer d’autres musiciens, on passait des annonces dans Jazz Hot : à l’époque, on ne lisait pas trop Jazz Mag qui nous paraissait trop pointu. On a alors constitué un groupe avec un vibraphoniste, une contrebassiste, un guitariste, un batteur et un trompettiste qui habitait deux rues plus loin que chez nous et qui était mauvais comme un cochon : un trompettiste classique raté qui faisait du cirque. On répétait dans ma chambre.
Le guitariste, c’était Georges Locatelli ?
Oui, très vite. Il est toujours en activité, il joue régulièrement à Paris, dans des clubs moins en vue que le Duc des Lombards. Il joue bien, il a un style magnifique. Quand je rencontre Georges Locatelli, je suis toujours au lycée. Je viens de faire du sport, je le vois passer avec une guitare. Tout ce qui était musicien, je sautais dessus. Lui avait quatre ou cinq ans de plus : il était en terminale. Je le rattrape et lui dis : « Tu es au lycée, tu joues de la guitare, du jazz ? Cela te plairait de jouer avec nous ? » Comme archi-amateurs, on jouait dans les surboums. A l’époque, dans les surprises-parties, on passait des disques mais il y avait aussi des gars qui jouaient. Le bassiste qui jouait avec nous, avec une contrebasse toute blanche en contreplaqué, faisait cela pour déconner, il espérait gagner un peu de tunes. André Fardin, le vibraphoniste, qui était plus âgé que nous, lui jouait très bien, genre Milt Jackson. Il jouait aussi de la guitare, il avait de beaux instruments mais il avait peur de jouer sur scène et de jouer avec des musiciens professionnels. Nous, nous étions de petits amateurs mais tellement passionnés : on ne faisait pas les zigomars, on était super sérieux. On ne faisait pas cela pour draguer les filles, il n’y avait que la musique qui comptait. On n’a pas décidé de « devenir » des musiciens de jazz, on « était » des musiciens de jazz, on ne s’est jamais posé la question. André Fardin, qui s’y connaissait en harmonie, avait relevé des morceaux à l’oreille, il n’y avait pas de partition. Après, quand on a été suffisamment âgé pour aller trouver les musiciens à la sortie des clubs, on coinçait des gens comme Georges Arvanitas qui connaissait mille et un standards, on lui disait : « Bonjour, M. Arvanitas, on a relevé Round about Midnight, est-ce que c’est correct ? » Il nous répondait : « Non, là, tu vois, c’est pas exact. » Et il nous corrigeait. C’est d’abord d’oreille, d’instinct, qu’on trouvait la musique et toujours maintenant, c’est comme cela, l’instant, l’oralité : l’oreille, après, il faut solidifier tout cela. Un jour, André arrive à la répétition à l’avance. Le jeudi soir, c’était notre Graal, notre plus beau jour de la semaine : on préparait la surboum du week-end. Comme il était à ‘avance, il se met à la contrebasse et il me dit : « Joue un blues en si bémol. » Je m’en rappellerai toute ma vie. Il prend la contrebasse et, comme il connaissait la guitare, il joue un vrai blues : je n’avais jamais entendu jouer de la contrebasse comme cela. Le mec qui jouait avec nous faisait n’importe quoi, il n’y avait pas d’ampli à l’époque. On disait seulement : « Ouvert – fermé ». André, lui, joue Blue Monk ou un truc comme cela, la vraie ligne de basse à la Ray Brown, parfaite. Il ne connaissait qu’un blues à la ligne de basse, il l’a joué quatre ou cinq fois et j’étais conquis : révélation comme le boogie. Terminé le piano, j’étais libéré. Au piano, je n’arrivais pas à m’exprimer, je ne le sentais pas : j’étais frustré. Je suis passé de la musique de Bechet, du New Orleans, à Thelonious Monk, direct. J’ai tout de suite été tenté par les dissonances de Monk, ça me fascinait et, en plus, ça me donnait le peu de liberté que j’avais ressenti auparavant : un jeu très rythmique, avec des dissonances, sans ces accords avec douze notes. Le premier disque que j’achète de ma vie, c’est un disque de Monk en solo. Après, avec Tabar Nouval qui joue aussi de la guitare, je prends la basse et ça me fascine. Je peux exprimer le rythme que je ressens. C’est drôle, je ne me suis pas dirigé vers la batterie, alors que si c’était à refaire, je jouerais peut-être de la batterie. Tabar Nouval m’a dit : « Sur cette corde-là, c’est do. » On a collé un petit morceau de papier. « En face, c’est fa, puis si bémol. Tu fais comme cela, tu écartes la main, tu serres et ça fait un ton, entre l’index et l’auriculaire, ça fait un ton. Puis, entre les deux et le majeur, ça fait un demi-ton ». Entretemps, quand je suis à l’armée, je me suis débrouillé pour tomber dans une musique militaire où je savais que je pourrais étudier au Conservatoire de Versailles, avec un immense professeur qui s’appelle Jacques Cazauran. Il recevait les contrebassistes de jazz parce qu’il avait un grand respect pour la musique de jazz et j’ai étudié quatre à cinq mois avec lui. Mais, c’est avec Alain Tabar Nouval que j’avais débuté la contrebasse.
La première fois que je vous ai entendu, c’était avec lui, au festival de Comblain-la-Tour, en 1965, je crois…
Oui, on jouait une sorte de free jazz, avec Georges Locatelli à la guitare. On passait juste avant Stan Getz qui, à l’époque, jouait avec Gary Burton, Steve Swallow et Roy Haynes. Quand on est sorti de scène, Swallow a félicité Alain, en lui disant qu’il le faisait penser à Eric Dolphy. Alain était aux anges.
Et après ?
Après j’ai joué avec Phil Woods et son European Rhythm Machine : Georges Gruntz puis Gordon Beck au piano et Daniel Humair à la batterie.
Vous avez beaucoup fréquenté les clubs à Paris ?
Énormément, le plus possible.
Vous y avez notamment rencontré René Thomas ?
Oui, vous me branchez sur un truc très émouvant. Le premier remplacement qui fait de moi un musicien professionnel, c’est avec René Thomas. A force d’être bassiste amateur, la seule manière d’approcher le milieu, c’était d’aller dans les clubs. A l’époque, c’était interdit au moins de 18 ans mais comme je suis très grand, je me débrouille pour entrer, déjà à seize ans et demi : j’avais juste trois poils au menton mais j’étais grand et je faisais plus âgé que mon âge. J’ai vu plein de musiciens, j’imitais Michel Gaudry et plein de contrebassistes, avec les yeux grands ouverts pour trouver le son. J’ai donc imité Michel Gaudry qui avait un très beau son, c’était la position de sa main qui me plaisait, il était très élégant et ça sonnait bien. Moi, j’étais le môme, j’avais juste remporté le prix du soliste à la contrebasse au concours du Salon de l’Enfant à 17 ans et demi. J’étais très énergique et hyper engagé physiquement. J’étais costaud et j’avais le tempo. Un soir, en fin d’après-midi, je vais au concert de Sonny Rollins à l’Olympia, où il y avait des concerts de jazz à 18 heures et à minuit. Entretemps, il y avait des variétés. J’arrive à me faufiler dans les coulisses. Sonny Rollins, avec Don Cherry, Bob Cranshaw et Billy Higgins : Our man in Paris. C’est un point clé pour moi. Je me faufile dans les coulisses. Le Blue Note, ça commençait à 22 heures, le club ultra prestigieux d’Europe, avec le Ronny Scott à Londres, le Golden Circle à Bruxelles. Le Blue Note, je n’y étais allé que deux ou trois fois, c’était trop cher pour moi. Il y avait deux orchestres en alternance, à 22 heures et à 4 heures du matin. Je croise Bibi Rovère qui était la star à l’époque, avec Pierre Michelot, qui était alors avec Jacques Loussier dans le projet Play Bach. A ce moment, les contrebassistes vedettes, c’était Luigi Trussardi, Michelot, Gaudry et Rovère. Bibi avait l’affaire au Blue Note, il faisait partie de la section rythmique maison pour des mois mais il avait des gigs sur le côté, il se faisait assez souvent remplacer. Là, il n’avait dû trouver personne et il me demande si je peux le remplacer. Je m’entends dire oui, sans vraiment réaliser et j’y vais. Je mets mon seul costume bleu marine, ma chemise blanche, ma cravate et j’y vais avec ma contrebasse. Et là, le patron du Blue Note, un affreux bonhomme ultra désagréable me dit ; « Tu laisses là ta contrebasse, tu prends celle de Bibi qui est sur le « stage » ». Moi, je refuse, je veux jouer avec ma contrebasse et là, je découvre que je fais deux trios avec Charles Bellonzi, un avec René Thomas, l’autre avec Bud Powell. J’avais déjà vu René, je savais qu’il parlait français, je savais l’immense musicien qu’il était, parce que je connais la valeur des musiciens, leur histoire : c’était une légende déjà à 32 ans comme les Daniel Humair, Bobby Jaspar, Benoît Quersin, René Urtreger, Pierre Michelot. J’étais terrorisé. Le premier trio, c’était avec Bud Powell : j’étais défait. Je ne connaissais rien : ces gens-là avaient un répertoire immense, ils montaient sur scène sans rien annoncer du tout : ils ne donnaient ni le titre des morceaux, ni le tempo qu’il fallait adopter. Tout le monde était supposé connaître. Là, René a été tellement gentil, il m’a sauvé la soirée. Quand on ne jouait pas, il prenait sa guitare, on se mettait dans un coin où on rangeait les vêtements et, avec son inimitable accent liégeois, il me demandait ce que je connaissais comme standard : « Est-ce que tu connais Softly as a morning sunrise ? Et tu connais Lover Man ? ». Il a passé en revue le peu de morceaux que je connaissais alors. Je sais que le premier morceau qu’on a joué avec Bud Powell, c’est un blues en fa et, après, c’est le trou noir et là, s’il n’y avait pas eu René et Charles Bellonzi aussi, j’étais perdu. Mais surtout René qui m’a pris vraiment la main.
Il aimait jouer avec de jeunes musiciens, il a souvent joué, notamment à Comblain, avec Jacques Thollot à la batterie…
Oui, René Thomas, c’était quelqu’un qui aimait les musiciens, la vie… Il n’a pas assez enregistré par rapport à d’autres musiciens. C’était quelqu’un qui vivait comme beaucoup de musiciens à cette époque-là, au jour le jour, j’ai connu la fin de cette époque-là. Et puis, René, il était un peu dans son monde, il était parfois éloigné de la réalité. Il était dans son univers, il était drôle, charmant, je l’ai adoré. Et j’ai rejoué avec lui par après. Attendez, parce que ce n’est pas fini avec René, c’est des trucs qui reviennent, vous êtes en train de remuer des souvenirs lointains. Il y a un autre club à Paris qui s’est ouvert quelques années après. Alors là, je suis Henri Texier, les musiciens savent qui je suis, j’ai à peine 22 ans, je deviens remplaçant attitré de Michel Gaudry au Blue Note. A l’époque, Michel est avec Gainsbourg, je joue deux à trois fois par semaine à sa place, parce que Gainsbourg a plein de galas : il se fait accompagner par Michel Gaudry et Elek Bacsik, le genre de rythmique terrible. Michel m’appelle chez le mec du bistrot d’en face, parce que je n’ai pas le téléphone : « Qu’est-ce que tu fais ce soir ? » Et, une demi-heure après, je suis au Blue Note. Pour lui, c’est le confort et, pour moi, c’est merveilleux : le rêve absolu. Cela se sait et tout à coup, il y a deux ou trois formations dont j’ai fait partie, non en tant que remplaçant mais comme contrebassiste titulaire. La plus importante, c’est quand Dexter Gordon jouait à Paris : c’est moi qui joue de la basse électrique, avec Art Taylor à la batterie et un pianiste qui est devenu un immense compositeur de musiques de film, Jean-Claude Petit, un pianiste génial à l’époque, hyper doué, à l’oreille parfaite. Et puis, il y a un groupe avec René Thomas et Jacques Pelzer et ça durait deux mois. J’ai dû aussi jouer au moins deux fois avec René dans un club qui s’appelait Jazzland, le club où Ornette Coleman et Sonny Rollins ont joué pendant un mois : ils ont fait l’ouverture du club avec Johnny Griffin, il y avait Eddy Louiss au piano, Art Taylor à la batterie et Alby Cullaz à la basse. Mais, sept mois après, le club s’est arrêté. C’était un club énorme, il avait quasiment supplanté le Blue Note. Là, j’ai joué avec Edgard Batman, un batteur incroyable que René Thomas et Jacques Pelzer vénéraient, il a été le professeur de Bob Moses, c’était un noir américain, bossu et qui avait un drumming extrêmement original. J’ai fait deux mois avec René et Jacques, c’étaient de drôles de zigomars, et moi, j’étais là au milieu, le « gaminou ». Cette époque-là, je l’ai vécue, j’ai l’impression de léviter : j’étais à 50 centimètres du sol. Tous ces mecs-là, je sais bien qu’ils avaient parfois de drôles de caractère, des lubies bizarres, et c’est un euphémisme. Mais, moi, j’en garde un souvenir merveilleux. Ils étaient gentils, attentionnés, ils m’aidaient. Ils ne me disaient pas : « Fais ceci, fais cela ». Ce qui était fabuleux avec ces musiciens, c’est ce que j’essaie de transmettre maintenant, c’est qu’ils ne faisaient pas de différence entre nous. Je ne savais rien. Jacques, je l’ai retrouvé à une autre occasion : Georges Gruntz dirigeait une sorte d’All Stars européen, il y avait Jacques et le Polonais Zbigniew Namyslowsky au saxophone, d’autres musiciens et moi à la contrebasse. Avec Jacques, on va faire une promenade en barque, je tiens les rames et, à un moment, je fais un faux mouvement, j’éclabousse le veston de Jacques. Et, avec son accent liégeois inimitable, il me dit : « Eh, fais attention, j’ai mes produits, moi là. » Je me souviens d’une autre petite anecdote : je jouais au Jazzland avec Dexter Gordon qui était adorable aussi. Je connaissais peu de standards. Jean-Claude Petit, un phénomène qui avait l’oreille parfaite, relevait les morceaux à la radio, il écrivait la musique, les accords. Il avait tous les Prix de Conservatoire, d’harmonie, de contrepoint, de dictée musicale. Moi, j’avais un « book » et, tout d’un coup, Dexter, qui voulait jouer une ballade, se tourne vers moi : « What do you want to play ? » « Euh, I can’t get started ? » Et on a joué… Lover Man. Tout cela, ce sont des souvenirs merveilleux.





